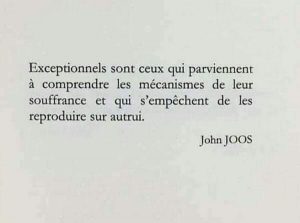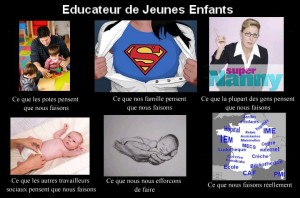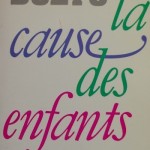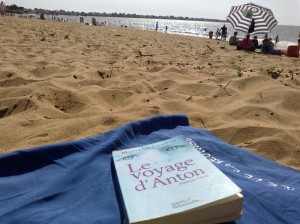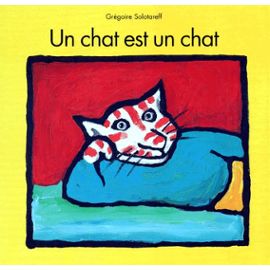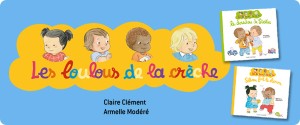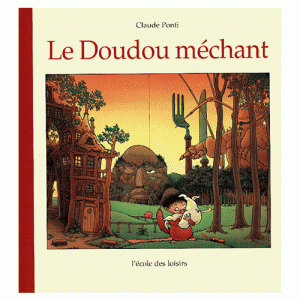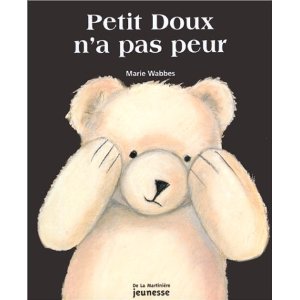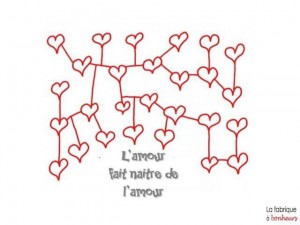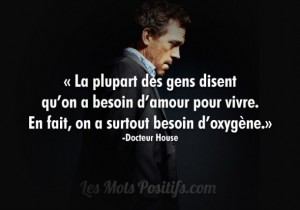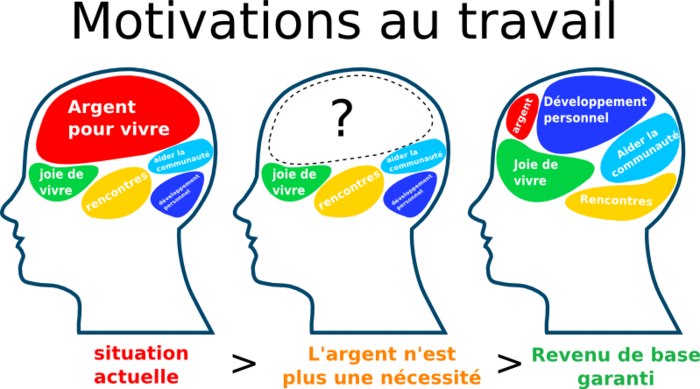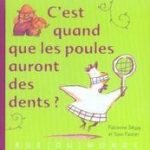Me revoilà en mode EJE (à prononcer Euh Ji Euh. J’entends encore des èje et ça me fait tout bizarre ;-)).
J’ai assisté récemment à une conférence de Miriam Rasse, invitée par la FNEJE pour représenter l’association Pikler-Loczy.
Voici telles quelles mes notes, à peine organisées et remaniées mais dans l’ordre de ce que j’ai entendu. Je suis beaucoup trop occupée pour prendre le temps de résumer, compiler et faire un écrit tout beau tout professionnel, désolée.
Voici donc une première partie, car j’en ai écrit des pages de notes et vu le contexte viral, je suis loin d’être en très grande capacité de faire fissa. ça tombe bien, je rappelle que j’hiverne encore.
L’attachement
est un moyen pour l’enfant de développer sa sécurité interne qui lui permettra d’évoluer
vers une autonomie propre et réelle.

Partie 1 : Les jeunes enfants accueillis ont profondément besoin d’être reconnus individuellement et de pouvoir compter sur et pour quelqu’un : quelles conditions pour construire une relation « à juste distance », même en collectivité ?
Rappel des spécificités des besoins d’un tout-petit :
Le nouveau-né, le nourrisson et encore le bébé ressentent des tensions internes. Ils expriment des besoins primaires, binaires. Leur mode de communication est gestuel, corporel et vocal.
« Penser bébé » nécessite une sensibilité pour une réception optimale, c’est primordial. Il est vital pour l’enfant qu’un adulte donne du sens à ce qu’il ressent (sensorialité) par une communication directe, en mettant à disposition son appareil psychique.
Ex : « Peut-être que tu as faim, cela fait 2 heures que tu as eu une tétée », « ta couche est souillée, je m’en occupe pour que tu te sentes plus à l’aise… » Etc.
Martine LAMOUR parle de « penser le bébé », c’est une communication encore plus élaborée qui nécessite un travail psychique intense de la part des adultes, une fatigue, voire un surmenage, surtout pour les mères qui portent leur bébé dans leur tête en permanence les premiers temps. La préoccupation primaire maternelle est vitale au bébé, mais peut amener à une dépression (+hormones) post-partum si la mère n’est pas soutenue dans sa fonction ; à force de tâtonnements, d’expérimentation de recherches et parfois sans solutions satisfaisantes. Mais cet état, s’il est supporté et soutenu est indispensable afin que l’enfant construise sa sécurité interne. C’est l’expression de la dépendance du bébé pour se maintenir en vie. Le statut de parent est ainsi valorisé même s’il est vécu comme « lourd ». C’est un long accompagnement vers l’autonomie qui se fait ni trop vite, ni pas assez.
L’enfant suit son développement et les adultes répondent afin que l’enfant se construise. Être des parents suffisamment bons donne du sens, cela organise la vie extérieure de l’enfant qui ensuite organise son monde interne.
A l’intérieur d’un bébé tout est chaos.

Il prendra donc appui sur la stabilité du monde externe qui lui sera proposé pour construire son monde interne avec des réponses immédiates à ses besoins dès la naissance. Il est capital d’y répondre, car le nouveau-né sort d’un état fœtal dans lequel il est nourrit, porté, au chaud en permanence, il ne ressent aucun état de besoin. A sa naissance, l’absence de contenance, de chaleur, de nourriture lui procure des sensations inconnues et donc des sensations de malaise qu’il n’identifie pas. Il n’a aucune expérience de la digestion et son système digestif se met en place peu à peu, ce qui cause souvent des désagréments pendant plusieurs semaines.
Le nouveau-né vit une période d’illusion, il pense qu’il crée lui-même les réponses à ses besoins et ses demandes, il croit s’auto-satisfaire. Comme les réponses vont s’espacer, le bébé découvre qu’il y a « quelqu’un » qui revient auprès de lui. Jusqu’alors il s’agit d’une odeur, une voix, une forme, un visage. Il découvre sa dépendance. Il découvre, éprouve et construit l’attachement. Le bébé est pragmatique, l’attachement n’est pas inné. Le bébé s’attache aux personnes qui prennent soin de lui, pas forcément à ses parents durant les premiers mois.
Etre suffisamment bon, cela signifie que l’adulte est suffisant (pas parfait), qu’il laisse un écart entre la satisfaction/réponse et la demande/besoin. L’enfant existe ainsi, il peut exprimer ce qui ne le satisfait pas.
Parallèlement, il découvre un environnement, un entourage, des personnes sur lesquelles il peut compter. Sinon, il est en grande insécurité. L’enfant peut ressentir des « angoisses inimaginables », « il peut se sentir « éclaté en morceaux ». Le nouveau-né insatisfait, qui attend trop longtemps éprouve la mort. Un rapport peut être fait avec les angoisses psychotiques des autistes, des angoisses qui semblent irraisonnées.
Les personnes sur lesquelles il peut compter sont la source de sa sécurité, c’est une sécurité acquise si ses besoins vitaux sont satisfaits dans l’immédiat.
Winnicott parle de relation fiable, stable, continue, prévisible. L’enfant a besoin d’une personne qui propose les mêmes choses dans les mêmes situations, une routine, une régularité, une stabilité. Cela explique que des enfants qui vivent des situations « limites » dans leur famille sont à la recherche de celles-ci en institutions car cela les rassure. Ils se sont construits sur ce mode de fonctionnement et ne connaissent que celui-ci. L’enfant peut amener tous les adultes à répéter ce qu’il vit même si c’est maltraitant.
Dans la régularité, l’enfant prend des points de repères. Il reconnait des signaux, il sait qu’ils se reproduisent. Il peut ainsi anticiper, se préparer et donc attendre. Il apprend à différer son besoin car il sait que son besoin sera satisfait comme d’habitude. Les expériences de satisfaction souvent vécues, il se les remémore. Il y participe de plus en plus et peut ainsi être actif, il contribue aussi à ses soins. Ce ne peut être le cas, si tout change à chaque fois car il ne sait pas ce qu’il va se passer, il reste dans l’incertitude. Il n’est pas impuissant car il est capable de reconnaître ses sensations. Son organisation interne qui se construit lui permet d’identifier ses besoins, de les communiquer car les adultes les différencient pour lui dès la naissance. L’enfant peut donc, avec le temps, donner des indications pour que ses besoins soient satisfaits. Il devient partenaire si l’adulte est attentif à ses expressions et ses indications. L’enfant va dire qui il est de manière singulière. Il réagit et montre quand il est apaisé, détendu ou au contraire crispé, mal à l’aise. Cela donne des indices sur les besoins de cet enfant-là. Y être attentif permet de s’ajuster à l’enfant, en cherchant la réponse adéquate. Quand les besoins sont satisfaits, l’ouverture au monde est possible. Si l’enfant est préoccupé par ses besoins, cela l’en empêche. Si un adulte cherche une réponse aux besoins exprimés de l’enfant, celui-ci sent que l’adulte est réceptif à ce qu’il exprime. Il se sent écouté, pris en compte. Ce que l’enfant exprime, influence le comportement de l’adulte. Cela rejoint le besoin de compétence (ne pas confondre avec capacité/système nerveux/développement/maturation) = l’enfant agit sur le monde, il a une influence, il est actif.
Un enfant peut vite renoncer à agir sur le monde. Il est appelé « docile », « facile », car il accepte tout, il a cessé d’exprimer qui il est car il a dit et n’a pas été entendu. Quand un individu n’est pas entendu soit il renonce car il n’existe plus et se replie sur lui-même soit il se révolte, se rebelle, il attaque, agresse avec toute sa force vitale. Il exprime souvent un sentiment d’impuissance.
L’adulte a la responsabilité d’être attentif à l’expression des besoins d’un enfant, de les prendre en compte. Quand l’enfant se sent entendu, il peut influencer le comportement de l’adulte puisqu’il se sent reconnu, considéré ce qui l’amène à construire son identité et son estime de lui. Il se sent important, bien dans sa peau. Cela participe à la construction des premières relations sociales. Le modèle d’écoute et de réponse des adultes qui l’entourent donne à l’enfant la façon de se comporter avec les autres. Le comportement de l’adulte induit celui de l’enfant avec ses pairs, entre autre.
Apprendre à l’enfant à exprimer son désir lui signifie qu’il en a le droit. L’accompagner à écouter ce que dit l’autre qui en a le droit aussi lui permet de prendre en compte son entourage et pas seulement son désir. L’enfant apprend car il l’expérimente, pas parce qu’on lui dit. (Les chemins de l’apprentissage, Spirale. Erès.)
Au fil du temps qui passe le bébé n’est plus dépendant ni impuissant.